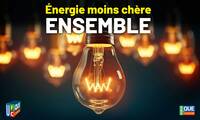Paris, le 1 avril 2025
Démarchage à domicile dans le secteur des travaux de
rénovation énergétique
L’ampleur des litiges impose son interdiction !
Une analyse effectuée par l’UFC-Que Choisir d’un millier de litiges individuels traités par ses associations locales démontre l’ampleur des pratiques nocives adoptées par certains professionnels de la rénovation énergétique dans le cadre de démarchages à domicile, et leurs conséquences désastreuses. Frappant notamment des personnes vulnérables, cibles privilégiées d’arnaques, ce démarchage constitue un procédé commercial délétère qui doit prendre fin. L’UFC-Que Choisir appelle en conséquence les Sénateurs et Sénatrices à interdire le démarchage physique relatif aux travaux de rénovation énergétique dans le cadre de la loi sur la fraude aux aides publiques examinée cette semaine.
L’UFC-Que Choisir accompagne de longue date les consommateurs et consommatrices en proie avec des pratiques déviantes de démarchages à leur domicile, particulièrement fréquentes dans le domaine de la rénovation énergétique. Les litiges individuels traités par ses associations locales témoignent d’un phénomène massif d’arnaques dont sont victimes les personnes démarchées sous couvert de rénovation énergétique.
Les chiffres accablants touchent principalement des consommateurs et consommatrices vulnérables
Dans les faits, nous recensons depuis 2018 près de 1000 litiges individuels de consommateurs et consommatrices portant sur des travaux de rénovation énergétique consécutifs à du démarchage à domicile. Les montants des préjudices invoqués par les
victimes sont énormes ! Avec une moyenne de 20 000 € par dossier, c’est pas moins de 20 millions d’euros de préjudice économique au global pour les seuls litiges traités par les associations locales UFC-Que Choisir !
Notre analyse révèle qu’une proportion importante de ces litiges concernent des personnes âgées ou en situation d’invalidité. Elles sont la cible privilégiée des démarcheurs qui associent discours techniques, fausses allégations et pressions psychologiques pour conduire la victime
à conclure un contrat l’engageant souvent sur des montants considérables, qu’elle n’aurait jamais signé dans des conditions de vente plus loyales. A titre d’illustration, la petite-fille d’un couple de personnes très âgées indique qu’ils ont subi « une pression énorme pendant plus de trois heures » les alarmant fallacieusement sur l’urgence à réaliser des travaux d’isolation et aboutissant à ce qu’ils paient immédiatement un montant supérieur à 9 000 euros !
Pour Marie-Amandine Stévenin, Présidente de l’UFC-Que Choisir « : Le démarchage à domicile lié à la rénovation énergétique est dangereux. Il repose sur nombre de pratiques pour leur arracher la signature d’ un bon de commande au montant
excessif et bien souvent non honoré. Et il ne s’agit pas de simples arnaques isolées, mais bel et bien d’un phénomène massif.. Il est donc urgent que les parlementaires prennent une mesure d’ordre public de protection des consommateurs avec son interdiction.»
Des pratiques commerciales toxiques et illégales pour tous les types de travaux de rénovation.
Aux pressions exercées par les démarcheurs pour que les consommateurs et consommatrices signent, le jour même de leur visite, des contrats coûteux, s’ajoutent de nombreuses autres pratiques commerciales déloyales, voire même des actes d’escroquerie et d’abus de faiblesse. Nous relevons notamment que les professionnels se font parfois indûment passer
pour des opérateurs publics ou mandatés par un organisme officiel sans révéler leur intention commerciale, que le délai légal de rétraction n’est ni mentionné ni respecté, et que les travaux sont régulièrement réalisés à la hâte avant même la fin de ce délai légal. Les personnes démarchées sont également fréquemment induites en erreur sur le montant des aides publiques que leur font miroiter les démarcheurs. Pire, le panel de litiges individuels analysés attestent que les travaux, lorsqu’ils sont effectivement réalisés, laissent souvent place à des malfaçons, qu’il s’agisse de travaux d’isolation du logement (30 % des dossiers), d’installation de pompes à chaleur (33 % des cas) ou encore de l’installation d’équipements de production
d’énergies renouvelables (37%).
Le succès de notre appel à témoignage confirme le fléau
En parallèle de l’analyse des litiges individuels recensés, l’UFC-Que Choisir a lancé un appel à témoignages1 sur le démarchage à domicile dans le secteur de la rénovation énergétique, qui en une seule semaine a recueilli, près de 400 retours. Plus de 78% des répondants indiquent avoir été démarchés récemment à leur domicile, montrant une nouvelle fois l’ampleur des visites à domicile non sollicitées dans le secteur. Des témoignages saisissants soulignent également les pratiques délétères des
professionnels de la rénovation énergétique confortées par les spécificités de ce mode de vente. A titre d’exemple, un particulier a été démarché à son domicile pour l’installation panneaux solaires pour un montant de 60 000 €. Le discours rassurant mais trompeur des démarcheurs expliquant que la revente d’énergie permettrait de combler la différence de prix a conduit le particulier à souscrire un crédit le jour même. Au final, l’installation des panneaux n’a jamais eu lieu…
Compte tenu des constats alarmants dressés, l’UFC-Que Choisir, soucieuse d’assainir les pratiques du secteur de la rénovation énergétique, appelle les Sénateurs et Sénatrices, qui examinent en ce moment une proposition de loi sur la fraude aux aides publiques, à voter l’interdiction du démarchage à domicile dans le secteur de la rénovation énergétique, prolongement logique de l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur, obtenue en 2020.
Contact presse :
Candice Tchoumjeu
ctchoumjeu@quechoisir.org
07.87.19.05.16

UFC-QUE CHOISIR
233 bd Voltaire
75555 PARIS CEDEX 11
Le 4 février 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’UFC-QUE CHOISIR : Marge minimale de 10 % garantie à la grande distribution. Mais où ont « ruisselé » les milliards d’euros ponctionnés aux consommateurs ?
L’effet inflationniste du relèvement du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires est aujourd’hui largement documenté. Dans ce contexte, l’UFC-Que Choisir rend aujourd’hui publique une nouvelle étude montrant qu’en revanche cette mesure n’a eu aucun impact mesurable sur l’augmentation du revenu des agriculteurs. En réalité, les difficultés économiques de ces derniers résultent d’un défaut flagrant d’encadrement des négociations commerciales. Dès lors, l’UFC-Que Choisir exige l’abandon immédiat du SRP+10 qui ponctionne sans aucune logique économique le pouvoir d’achat des consommateurs, ainsi que la mise en œuvre urgente de sanctions dissuasives contre les industriels et les enseignes qui imposent aux agriculteurs des tarifs en dessous des prix de revient.
Six ans après la première loi Egalim et malgré deux lois supplémentaires, les pouvoirs publics n’ont toujours pas publié de données précises, filière par filière, sur la mise en œuvre de leurs dispositions (contractualisation, prix rémunérateur, prise en compte automatique de l’évolution des coûts de production…), ni sur leur efficacité à défendre le revenu agricole. Afin d’alimenter le débat en amont de la future loi Egalim , l’UFC-Que Choisir a étudié l’évolution du revenu agricole1 sur le long terme et particulièrement depuis 2019 pour 4 grandes productions (céréales et oléagineux, porc, viande bovine et lait), ainsi que les données et analyses disponibles permettant d’identifier les véritables causes de l’échec d’Egalim.
SRP+10, un surplus d’inflation pour les consommateurs sans impact sur le revenu agricole En l’absence de démonstration économique2, l’argumentaire déployé pour justifier la marge minimale de 10 % garantie à la grande distribution, était que par effet de « ruissellement » les sommes supplémentaires prélevées sur les consommateurs allaient permettre une revalorisation des prix d’achat consentis par les enseignes aux industriels, ces derniers étant ensuite censés reverser ces sommes aux agriculteurs. L’étude réalisée par l’UFC-Que Choisir montre qu’en réalité le revenu agricole a baissé en 2019, année de la mise en œuvre du SRP+10, pour 3 filières étudiées (céréales, viande de porc et de bœuf) et stagné pour la filière
laitière. Ce n’est donc absolument pas au bénéfice de nos agriculteurs que les consommateurs ont subi une inflation supplémentaire – reconnue aussi bien par le monde agricole et industriel, que par les parlementaires représentant entre 470 millions d’euros et 1 milliard d’euros par an selon les estimations, soit au total plusieurs milliards d’euros depuis son entrée en vigueur il y a près de 6 ans.
Prix agricoles : des formules de prix opaques et peu rémunératrices Alors que les prix agricoles stagnaient globalement depuis 2010, ils ont progressé de 45 % entre juillet 2020 et janvier 2023, entraînés par la hausse généralisée des cours internationaux. Pourtant, cette envolée spectaculaire n’a pas permis aux exploitations les plus fragiles de disposer de revenus rémunérateurs,
notamment pour celles de la viande ou du lait, la hausse des prix agricoles étant insuffisante pour compenser le renchérissement des coûts de production. Pour les filières céréalières, on évoque entre 60 et 65 %
1 Les valeurs d’excédent brut d’exploitation (EBE) issues des statistiques agricoles officielles ont été choisies pour traduire
l’évolution des revenus, l’EBE étant un indicateur couramment utilisé pour mesurer l’efficacité économique. Source
principale des évolutions de revenu : ‘Résultats économique des exploitations en 2022’ – Primeur n°14 – Agreste –
Décembre 2023
2 Dans le rapport du ministère des finances au Parlement, les économistes ont indiqué que ‘’l’idée d’un ‘ruissellement
automatique’’ n’a pas de fondement économique’’, le prix agricole dépendant avant tout des conditions de négociations
commerciales – Évaluation des mesures expérimentales de relèvement du seuil de revente à perte et d’encadrement
des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires – F. Gardes, C. Bonnet – 2021.
3 En 2019, l’UFC-Que Choisir a relevé des hausses considérables dans les grandes marques d’aliments courants (par
exemple + 5,5 % sur l’Emmental, + 5,5 % sur les raviolis en boîte, +6,2 % sur les colas…), ainsi que de fortes hausses
sur les aliments d’entrée de gamme.
4 Rapport d’information n°5109 sur l’évaluation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous –
Assemblée d’exploitations ayant un revenu inférieur au SMIC sur cette période. Quant aux élevages porcins, beaucoup
d’entre eux ne doivent leur survie qu’à l’aide d’urgence de 400 millions d’euros débloquée en 2022 par l’État.
Pourtant, Egalim prévoit une revalorisation automatique des prix tenant compte des coûts de production, mais la Cour des Comptes a constaté que les indices de prix utilisés dans les contrats sont souvent trop peu rémunérateurs, reflètent mal les évolutions réelles des coûts, voire sont inexistants6. En outre, pour garantir aux éleveurs une stabilité des revenus et des volumes achetés, une contractualisation pluriannuelle avec les industriels est obligatoire par exemple pour la filière bovine. Pourtant, dans la pratique seulement un quart de la viande y était soumis en 2023 !
Des négociations commerciales toujours déséquilibrées À l’origine de ces criants échecs, on trouve le rapport de force toujours déséquilibré entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution. Les quelques 90 000 exploitations bovines et laitières doivent négocier leurs productions avec un nombre d’acheteurs très réduit : pour le lait, 28 laiteries collectent 76 % des volumes et pour la viande 143 abattoirs assurent 92 % des tonnages. La concentration est encore plus marquée dans
la filière porcine où par exemple en Bretagne 90 % des abattages sont réalisés par seulement 5 groupes. En position de force, les groupes industriels peuvent s’autoriser à revenir sur des accords signés. Ainsi, Lactalis, après une négociation difficile sur les prix, a annoncé unilatéralement en septembre l’arrêt de la collecte pour 300 exploitants d’ici 2026. De même le groupe Savencia (Caprice des Dieux, St Moret, Cœur de Lion…), est en désaccord depuis 3 ans avec les prix demandés par les producteurs. Face un tel déséquilibre, seuls les pouvoirs publics ont la capacité de rétablir l’équité dans les négociations,
en contrôlant la bonne application des lois et en sanctionnant les contrevenants. Cependant, les sanctions sont extrêmement faibles. Ainsi l’amende infligée récemment à Carrefour ne représente que 0,03 % de son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, les industriels et la grande distribution ont en réalité les coudées franches pour imposer leurs conditions aux agriculteurs.
Au regard des défaillances criantes relevées dans la mise en œuvre des lois Egalim et alors que les prix agricoles français sont de plus en plus soumis aux variations du marché mondial, il importe de faire appliquer les mesures les plus efficaces pour défendre à la fois le revenu agriculteurs et le pouvoir d’achat des consommateurs. À cet effet, l’UFC-Que Choisir demande :
• La mise en œuvre effective du rééquilibrage des négociations commerciales, par :
– L’établissement d’indices de prix interprofessionnels fiables ;
– Un renforcement de la contractualisation ;
– La publication des conditions des négociations commerciales ;
– L’application de sanctions dissuasives en cas de non-respect de la loi et de prix
producteurs en dessous du prix de revient.
• La transparence totale dans la construction des prix en publiant, sous la responsabilité de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, les niveaux de marges nettes réalisées pour chaque catégorie de produits, par les industriels et les enseignes de la grande distribution ;
• Un abandon immédiat du relèvement du seuil de revente à perte.
5 Afin de soutenir la filière porcine en difficulté, l’État a débloqué en 2022 un premier plan de sauvegarde doté de 270
millions € qui a bénéficié à 3 100 éleveurs, puis un second volet doté de 133 millions € versé à 3 700 éleveurs.
6 Alors que la loi exige au minimum deux indicateurs des prix de production dans les contrats, sur les 9 contrats en viande
bovine examinés par la Cour des comptes, 5 ne contenaient aucun indicateur de coûts.
 Le 23 janvier 2025
Le 23 janvier 2025
UFC-QUE CHOISIR
233 bd Voltaire
75555 PARIS CEDEX 11
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Polluants éternels dans l’eau du robinet
Une large présence détectée dans 96 % des communes testées
L’UFC-Que Choisir et Générations Futures dévoilent aujourd’hui une étude préoccupante sur la
présence massive des PFAS, surnommés « polluants éternels », dans l’eau du robinet. Ces
substances quasi indestructibles et toxiques pour certaines d’entre elles ont été détectées dans 29
des 30 prélèvements analysés par les associations, y compris dans de grandes villes comme Paris,
Lyon et Bordeaux.
Des substances omniprésentes et mal réglementées
Générations Futures et l’UFC-Que Choisir ont analysé 33 PFAS dans l’eau potable de 30 communes
françaises. Les résultats sont alarmants :
• Le TFA, un résidu notamment de certains pesticides, a été détecté dans 24 prélèvements sur 30,
notamment à Paris ou dans des communes des agglomérations de Poitiers et Orléans ;
• Certaines zones, comme Tours ou les environs de Rouen, présentent un véritable cocktail
chimique, avec respectivement 10 et 11 PFAS différents relevés dans un seul prélèvement.
Malgré ces découvertes alarmantes, ces concentrations en PFAS (hors TFA) restent conformes à la norme
choisie par la France (somme de 20 PFAS spécifiques limitée à 100 ng/l), bien moins strictes que celles
d’autres pays. À titre de comparaison :
• Avec la norme américaine (4 ng/l pour 2 PFAS), 6 prélèvements (sur 30) dont ceux de Rouen et
Amiens seraient considérés comme non conformes ;
• Avec la future norme danoise sur les PFAS, encore plus stricte, (2 ng/l pour la somme de 4
molécules spécifiques), 15 prélèvements (sur 30) dépasseraient les seuils admissibles, notamment
à Bordeaux et Lyon.
Par ailleurs, les concentrations de TFA détectées, excéderaient la limite applicable aux pesticides1 dans 20
prélèvements sur 30. Une situation d’autant plus préoccupante que cette substance n’est pas recherchée
dans les contrôles réglementaires en France.
Si l’on appliquait simultanément les normes danoises sur les PFAS et les seuils français pour les pesticides,
plus de 80 % des prélèvements (25 sur 30) ne respecteraient pas au moins l’une de ces exigences. Ces
comparaisons montrent clairement à quel point la France adopte une approche peu exigeante pour la
protection des consommateurs.
La France à la traîne
En l’état, la norme française sur les PFAS prévue au plan de contrôle pour 20262, (100 ng/l pour la somme de
20 PFAS) est bien trop peu protectrice d’autant qu’elle ne repose sur aucune donnée toxicologique solide.
Nous ignorons encore l’ampleur réelle des dangers posés par l’ensemble de ces substances sur la santé.
Cependant, des études lient déjà certaines à des risques accrus de cancers, de maladies thyroïdiennes ou de
troubles hormonaux.
Face à ces incertitudes, il est urgent que la France applique le principe de précaution :
• En évaluant précisément le danger induit par le TFA et en l’intégrant au plan de contrôle de l’eau
du robinet ;
1 Une norme de 100 ng/l s’applique aux pesticides ainsi qu’à leurs produits de dégradation évalués comme pertinents. Les
autorités sanitaires n’ont pas encore évalué le TFA malgré plusieurs demandes de Générations Futures. Son évaluation
conduirait vraisemblablement à classer le TFA comme métabolite pertinent au vu de la méthodologie définie par l’Agence
Sanitaire Française.
2 À partir de 2026, la France appliquera la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (dites « de boisson »).
• En adoptant des normes plus strictes et protectrices basées sur des données scientifiques
récentes ;
• En renforçant les contrôles sur les rejets industriels et en interdisant les pesticides classés comme
PFAS.
Il est temps d’agir !
L’UFC-Que Choisir et Générations Futures demandent aux parlementaires d’agir rapidement en votant
sans délai la proposition de loi, adoptée en première lecture au parlement, visant à interdire ces
substances dans les produits du quotidien, à réduire drastiquement les rejets industriels et à imposer
aux entreprises de financer la dépollution.
 Plus de 10 millions de Français sans alternatives à la voiture ?
Plus de 10 millions de Français sans alternatives à la voiture ?
L’UFC-Que Choisir révèle les « zones blanches » de l’accès aux transports publics
Alors que les transports sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre et que le recours aux transports en commun plutôt qu’au véhicule individuel est un levier primordial pour réduire ces émissions et les dépenses des consommateurs, l’UFC-Que Choisir publie aujourd’hui uneétude exclusive sur l’accessibilité des transports en commun en France. Ce rapport dévoile de fortes disparités géographiques, qui laissent de trop nombreux citoyens sans alternatives crédibles à la voiture. Compte tenu de cette situation, l’association lance ce jour, avec ses associations locales, une campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation #LaMobilitéUnePriorité à destination des consommateurs et des pouvoirs publics. Ces derniers doivent plus que jamais agir pour permettre au plus grand nombre de disposer d’un accès à une offre de qualité de transports en commun.
LOI Habitat dégradé :
De nouvelles dispositions visant à améliorer le fonctionnement des copropriétés
Publié le 22 avril 2024 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
S’agissant des copropriétés, la loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 prévoit notamment : une simplification du recours à l’emprunt collectif pour financer des travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble ; ainsi qu’une obligation pour les syndics d’informer les occupants et propriétaires d’un immeuble lorsque celui-ci est touché par une procédure de lutte contre l’habitat indigne.

La loi du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement comporte plusieurs mesures relatives aux copropriétés. Ces dispositions portent entre autres sur :
- les travaux réalisables et le financement de ceux-ci ;
- les informations devant être délivrées aux copropriétaires ;
- la procédure de recouvrement de charges impayées par un copropriétaire.
Des mesures sur les travaux pouvant être engagés dans une copropriété
Chaque copropriétaire a désormais la possibilité de faire réaliser, à ses frais, des travaux d’isolation thermique concernant la toiture ou un plancher, y compris s’ils sont de nature à affecter les parties communes de l’immeuble. Ces travaux ne doivent pas porter atteinte :
- à la structure de l’immeuble ;
- à la sécurité et à la salubrité du bâtiment ;
- aux éléments d’équipements essentiels de l’édifice ;
- aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires.
Par ailleurs, la loi « Habitat dégradé » assouplit les conditions dans lesquelles une assemblée générale de copropriétaires peut décider de recourir à un emprunt collectif. Une copropriété peut souscrire ce type de prêt, au nom du syndicat des copropriétaires, pour financer la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble. Un tel emprunt ne devra plus forcément être adopté à l’unanimité en assemblée générale. Il pourra être adopté à la majorité (selon les mêmes règles déjà applicables pour le vote des travaux que l’emprunt permet de financer).
Un copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt. Il doit alors indiquer son refus explicitement au syndic, au maximum 2 mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ; et il doit verser la totalité de la part du prix des travaux qui lui revient, au maximum 6 mois après la notification de ce procès-verbal.
Une autre évolution : il est désormais possible de convoquer, dans un délai de 3 mois, une nouvelle assemblée générale pour voter un projet de travaux de rénovation énergétique ayant recueilli moins du tiers des voix de tous les copropriétaires lors d’un premier suffrage. Pour être retenu, le projet doit alors recueillir la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Des dispositions concernant les informations données aux copropriétaires
Un syndic a désormais l’obligation d’informer les occupants et propriétaires d’un immeuble lorsque celui-ci est touché par une procédure de lutte contre l’habitat indigne. Cette information permet à chacun de prendre conscience et connaissance des risques. Ce type de procédure peut en outre générer des droits pour les locataires (suspension du loyer, hébergement ou relogement pendant ou à l’issue des travaux effectués…).
La loi « Habitat dégradé » prévoit, par ailleurs, qu’un syndic peut désormais transmettre aux copropriétaires les courriers de notification ou de mise en demeure de manière dématérialisée, sans nécessairement avoir reçu leur accord explicite pour effectuer les envois ainsi. Le syndic doit en revanche les informer qu’ils peuvent continuer à recevoir ces informations par courrier postal s’ils le souhaitent.
Enfin, lorsque la résiliation du contrat de syndic vient d’une demande du conseil syndical, le syndic doit désormais convoquer une assemblée générale au maximum 2 mois après la première présentation de la lettre recommandée, si le président du conseil syndical en exprime le souhait. Si cela n’est pas fait, le président du conseil syndical peut alors convoquer lui-même l’assemblée générale.
À noter
La loi « Habitat dégradé » ajoute une nouvelle situation pour laquelle un syndic n’a pas besoin d’une autorisation préalable d’un juge pour procéder au recouvrement d’une créance auprès d’un copropriétaire. Désormais, cela est également possible pour un défaut de paiement des provisions exigibles au titre du budget prévisionnel de la copropriété.
Application Quelproduit de l’UFC Que-Choisir : Le Réflexe Malin pour consommer plus sain !
69 % des origines masquées dans les produits transformés : Une obligation d’affichage s’impose

En réponse à la crise du revenu agricole, due notamment aux importations à bas coût, et face à la demande de transparence des consommateurs, Olivia Grégoire annonce la présentation en mai du visuel « l’Origine-info » qui affichera de manière synthétique les différentes origines des ingrédients composant un aliment. Alors que les industriels réclament que ce futur affichage reste volontaire ou ne soit disponible que sur Internet, l’UFC-Que Choisir publie aujourd’hui une étude exclusive révélant que l’opacité concerne plus des deux tiers des ingrédients dans les produits transformés qu’elle a examinés. Face à ce constat, l’Association demande à Madame la Ministre que le futur visuel soit obligatoire et figure sur la face avant des emballages.
Pour les consommateurs, la transparence sur l’origine des aliments qu’ils consomment est une exigence prioritaire, avant même le prix[1], sachant que la qualité sanitaire ou l’impact environnemental d’un ingrédient peut varier considérablement selon l’origine. Si l’indication de provenance est obligatoire pour les produits bruts (viandes, volailles, poissons, légumes et fruits), il n’en est rien pour les produits transformés, alors même que ceux-ci représentent la plus grande part de notre alimentation. Cette opacité explique pourquoi 35 % du bœuf et plus de la moitié du poulet utilisé dans les aliments industriels sont importés[2], alors qu’au rayon frais les viandes sont quasi exclusivement françaises du fait de l’affichage obligatoire.
Alors que les représentants de l’industrie réclament que le futur visuel reste facultatif, l’UFC-Que Choisir a tenu à vérifier si le volontariat, qui prévaut actuellement, suffit à informer correctement les consommateurs. À cet effet, l’Association a relevé et analysé les mentions figurant sur les emballages d’un échantillon de 243 aliments transformés de grandes marques, couramment trouvés en rayon (conserves, plats tout préparés, salades, sandwich, jambon, charcuteries…) représentant au total 484 ingrédients principaux[3] carnés (bœuf, porc, volaille) et végétaux (céréales et légumes).
Le volontariat, c’est jusqu’à 84 % d’opacité sur les ingrédients !
Pour 69 % des ingrédients que nous avons examinés, l’opacité règne sur leur origine : 47 % d’entre eux n’ont aucune origine mentionnée et 22 % une origine purement générique avec des mentions floues du type « origine UE » ou « non UE ». Dans le détail, c’est pour les céréales et les légumes, catégorie d’aliment n’ayant jamais fait l’objet d’une obligation d’étiquetage, que le manque d’information est le plus marqué avec 84 % d’ingrédients sans origine précise mentionnée, suivie par la volaille (64 %), le porc (38 %) et le bœuf (32 %).

La transparence ou l’opacité au bon vouloir des marques !
Parmi les 14 marques alimentaires ou de distribution analysées, on observe des différences considérables en termes de transparence pour des produits de mêmes gammes et de compositions comparables. Au rayon frais par exemple, Marie donne l’origine précise de plus de 8 ingrédients sur 10 pour les plats préparés de notre échantillon, là où Fleury Michon ne le fait que pour près d’un ingrédient sur 5. De la même manière, si Bonduelle communique la provenance précise pour 7 légumes sur dix, Cassegrain ne le fait que pour près d’un légume sur 10[4]. Ceci démontre que l’opacité n’est pas due, comme le prétendent certains industriels, à une variabilité inévitable des provenances d’ingrédients mais bien à des politiques d’approvisionnement propres à chaque marque.

Pire, quelques marques n’hésitent pas à pratiquer ce qui pourrait être qualifié de « french washing » pour certains produits, comme Fleury Michon qui met en avant son caractère familial et vendéen depuis 1905 ou Sodebo qui se targue d’être une entreprise française sur un fond tricolore et qui vante ses ateliers situés dans une commune à consonance champêtre, alors même qu’aucune indication n’est donnée sur l’origine française des ingrédients utilisés pour ces produits[5].
L’« origine-info » d’Olivia Grégoire doit être obligatoire et figurer sur l’emballage
Le futur affichage sera sans effet s’il reste volontaire, comme le prouve l’exemple de la viande de bœuf : l’obligation d’étiqueter les ingrédients carnés appliquée en 2017 avait alors fortement contribué à la transparence, mais l’abandon de cette mesure en 2021 a malheureusement fait progresser l’opacité sur les produits à base de bœuf qui est remontée de 25 % en 2018 à 32 % aujourd’hui. Faut-il rappeler que l’opacité participe à l’extrême variabilité des approvisionnements qui met en danger la traçabilité des produits et la qualité sanitaire, comme l’a montré le scandale des lasagnes à la viande de cheval ?
Au regard de l’impact sanitaire et environnemental de l’origine des ingrédients et afin de permettre aux consommateurs de comparer les produits et de les acheter en toute connaissance de cause, l’UFC-Que Choisir demande à Olivia Grégoire de rendre obligatoire « l’Origine-info », comme le permet le règlement européen encadrant l’étiquetage des aliments, et de le faire figurer sur la face avant des emballages alimentaires.